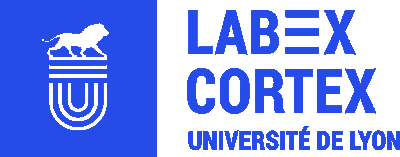Neuroatypiques, les gens connaissant des troubles du spectre de l’autisme peuvent être fortement affectés par l’environnement bâti. A l’Institut des Sciences Marc Jeannerod (ISC-MJ), des travaux de recherche explorent une nouvelle discipline, la neuro-architecture, qui vise à concevoir des bâtiments favorisant le bien-être lorsqu’ils sont arpentés par les personnes autistes.
Firmitas, utilitas, venustas. Autrement dit « solidité, utilité et beauté ». Ces trois principes édictés par l’architecte romain Vitruve constitue, depuis deux millénaires, le fondement de toute conception architecturale qui doit, en outre, assurer le bien-être de ses futurs occupants. Lieu de travail, logement, administrations, espaces sportifs… On estime que l’être humain passe 90% de son temps dans des espaces intérieurs dont la conception architecturale a une influence non négligeable sur sa santé mentale. Cette observation est essentielle lorsqu’on s’intéresse au bien-être des personnes concernées par des Troubles du spectre autistique (TSA) qui, à cause d’une perception de l’espace différente de la normale, peuvent souffrir, plus que d’autres, des stimulations sensorielles générées par l’environnement bâti.
Peut-on imaginer que l’architecture évite cet écueil et que sa conception soit, au contraire, source de soulagement quotidien pour les enfants et adultes concernés par l’autisme ? Cette réflexion est menée depuis peu par plusieurs architectes dont la démarche novatrice s’inscrit dans un courant récent appelé la neuro-architecture.
La lumière, la température et l’acoustique définissent l’ambiance globale d’un environnement bâti
Mon travail de recherche s’inscrit dans ce contexte. Architecte de métier, j’explore ce domaine nouveau dans le cadre de ma thèse dirigée par Angela Sirigu au sein de l’équipe Disorders of the brain de l’ISC. Mon objectif ? Élaborer un cadre d’analyse et de références qui, basé sur des connaissances de l’autisme, permette d’orienter un projet architectural en faveur du bien-être des personnes TSA. Tendre vers une architecture qui soit au service des porteurs de l’autisme ainsi que de leurs accompagnants. Car aucun bâtiment n’a encore été conçu de la sorte.
Pour ce faire, nous avons initié des discussions enrichissantes avec Isabella Pasqualini, spécialiste de la neuro-architecture à l’Université de Genève, et Nicolas Georgieff, psychiatre à l’hôpital du Vinatier et spécialiste de l’autisme et des troubles du neurodéveloppement. A travers ce projet de recherche collaboratif, il s’agit d’explorer le sens de l’espace et sa valeur en tant que récompense pour les personnes autistes.

Comment appréhender l’effet que peut avoir l’architecture d’un bâtiment sur le cerveau ? Selon plusieurs études en neurosciences, les paramètres comme la lumière, la température, l’acoustique -entre autres- définissent, à un niveau global, l’ambiance caractéristique d’un environnement bâti. Or ces paramètres, que nous percevons de façon inconsciente, modifient notre activité cognitive.
C’est la région du gyrus parahippocampique, autrement appelé l‘aire de place parahippocampique (PPA), qui s’active avant tout lorsque nous sommes immergés dans une architecture. Situé dans le cortex, en dessous de l’hippocampe, cette zone joue un rôle important dans l’encodage et la reconnaissance d’images de lieux et de scènes. Elle est en partie responsable de la formation de la mémoire spatiale.

Les neuroscientifiques ont noté en effet que l’aire PPA devient très active lorsqu’une personne regarde une scène complexe comme un espace meublé, ou un paysage riche en couleurs et détails différents. L’activité de la zone PPA n’augmente pas lorsque la personne se trouve dans un environnement familier. Mais elle s’amplifie lorsqu’on est exposé à de nouveaux lieux en comparaison avec d’autres déjà appréhendés.
Parallèlement, on sait aussi que l’atmosphère d’un lieu joue sur la libération d’hormones au sein du cerveau. Des expériences ont montré que, dans un espace non convivial, c’est-à-dire où la sociabilité est faible, le cerveau augmente sa production en adrénaline et en cortisol, deux hormones associées à la peur et l’anxiété. Au contraire, si l’individu se trouve dans un espace communicatif, le cerveau produit de l’ocytocine, l’hormone de la liaison et de l’attachement, et de la sérotonine, l’hormone associée à la détente et au plaisir. Cette association, étonnante, entre expérience d’un lieu et production de neurohormones n’a pas été approfondie jusqu’à présent par les architectes.
On accumule des informations sur la façon avec laquelle les êtres humains expérimentent l’espace
Pour investiguer ces questions de neuro-architecture, des architectes, réunis au sein de l’Académie de neurosciences pour l’architecture (Anfa), utilisent aujourd’hui des techniques d’imagerie cérébrale et des programmes de réalité virtuelle, des outils qui n’existaient pas lorsque ce courant de pensée est né il y a 20 ans. Grâce à ces outils, il est possible d’observer les zones cérébrales stimulées lorsqu’une personne traverse un espace. Ces zones sont liées aux actions de déplacement, à la visualisation mais aussi aux sentiments et aux émotions. Elles sont associées à la perception, aux ressentis émotionnels et à la cognition.
Mais si l’espace traversé évolue, que se passe-t-il ? Pour le savoir, on réalise de nouvelles acquisitions. Progressant de la sorte, de précieuses informations sont accumulées sur la façon dont les êtres humains vivent et expérimentent leur environnement. Ces données peuvent constituer une base de réflexion utile aux architectes pour concevoir l’espace de sorte qu’il contribue au soin et à une thérapie.
L’effet de l’architecture et de l’espace sur le cerveau humain est un objet d’étude relativement nouveau qui existe aujourd’hui, grâce au travail de différents experts (Isabella Pasqualini, Jhon Paul Eberhard, Steven Holl, Juhani Pallasma par exemple) comme une discipline à part entière. La neuro-architecture est un domaine de recherche qui couvre depuis peu des maladies psychiatriques comme la maladie d’Alzheimer, la schizophrénie ou le trouble bipolaire.
A l’origine de la neuro-architecture, de premiers bâtiments exemplaires
En 2003, un groupe d’architectes de l’AIA (American Institute of Architects) réunis à San Diego (Californie) se sont lancés dans un projet combinant architecture et neurosciences en fondant l’Académie des neurosciences pour l’architecture (Anfa) (en anglais l’Anfa ou « Academy of neuroscience for architecture »), une organisation à but non lucratif.
Grâce à des études menées conjointement par des architectes et des neuroscientifiques, il est question de saisir comment le cerveau humain perçoit et réagit aux repères architecturaux. Le but étant de permettre aux utilisateurs d’un espace d’exprimer pleinement leurs potentiels et leur créativité.

Basilique d’Assise en Italie © Shutterstock | Nicola Pulham
La création de l’association doit beaucoup au premier projet qui, en 1960, a fait l’objet d’une approche neuro-architecturale. L’Institut Salk, situé à San Diego. Son fondateur, le docteur Jonas Salk, découvreur du vaccin contre la poliomyélite, a en effet travaillé avec Louis Khan, l’un des plus grands architectes du XXe siècle, pour concevoir ce centre de recherches dédié aux études biologiques afin d’en faire un endroit accueillant et source d’inspiration pour les chercheurs. Origine de l’idée ? L’expérience esthétique vécue par le médecin lors de la visite d’une abbaye à Assise (Italie) et qui, d’après ses dires, l’a aidé à sortir de l’impasse réflexive dans laquelle il se trouvait à l’époque pour mettre au point le vaccin. Abritant près de 50 laboratoires, les bâtiments de l’Institut sont modernes, ouverts et spacieux.
En 2003, dans un premier événement consacré au dialogue entre neurosciences et société, l’Anfa a célébré l’architecte Franck Ghery pour son projet de « Maggie’s center » bâti cette année-là à Dundee (Écosse). S’inspirant de l’habitation traditionnelle écossaise, le bâtiment est un exemple de lieux au service des malades. Calmes et tranquilles, les « Maggie’s center » permettent aux patients atteints de cancer de se rassembler avec leur famille pour se soutenir, en dehors d’un environnement médical traditionnel et ressenti comme aliénant.
Aucune étude de neuro-architecture n’a encore été produite en lien avec des troubles autistiques, bien que l’architecture pour l’autisme existe bel et bien depuis les années 80. Mais ce dernier mouvement, au lieu d’expérimentations dans le champ des neurosciences, se nourrit en grande partie de constats et d’observations personnelles de la part des architectes qui se présentent comme spécialistes des troubles du spectre autistique. Or, on constate que, lorsqu’il s’agit de concevoir un bâtiment dédié à la prise en charge des personnes TSA, les méthodologies observées via cette approche se contredisent sur beaucoup d’aspects conceptuels.
Désirant s’affranchir d’observations intuitives telles que réalisées jusqu’à présent, mon travail de doctorat s’appuie sur une méthodologie scientifique associant neurosciences et sciences cognitives pour comprendre l’influence de l’espace environnant sur le fonctionnement cérébral, et plus particulièrement celui des personnes TSA. Pour ce faire, mon projet de recherche prévoit d’associer des personnes autistes, et des personnes neurotypiques, à des expériences visant à comprendre comment l’espace bâti impacte leur fonctionnement cérébral et comportemental. Avec la volonté que les données recueillies soient utiles, par la suite, pour identifier les qualités de l’espace les plus propices au bien-être des personnes touchées par l’autisme.
Les avancées dans le domaine des neurosciences, les partenariats déjà établis entre architectes et neuroscientifiques, l’intérêt croissant de ces derniers pour l’étude des régions du cerveau impliquées dans le processus de la perception et du vécu des lieux, sous-tendent ma motivation à vouloir associer neurosciences, architecture et problématiques de l’autisme. Cette interdisciplinarité offre un vaste champ d’investigation à explorer qui pourrait permettre de créer -ou de réhabiliter- une architecture adaptée aux besoins souvent non formulés de la population TSA.