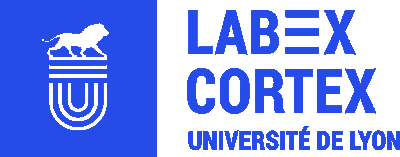La lecture du roman d’Adrian Tchaikovsky, Dans les profondeurs du temps, nous plonge dans un monde peuplé de pieuvres super-intelligentes qui ont progressivement remplacé l’Homme. Leurs capacités cognitives hors-normes témoignent d’un cerveau très différent du nôtre.
Quand des œuvres de science-fiction interrogent les neurosciences : épisode #4
Crédit image centrale © Quentin Lemaître avec ChatGPT
Lorsqu’elle dort, et peut-être lorsqu’elle rêve, elle le fait en couleurs. Son sang est bleu, qui circule en elle grâce à trois cœurs. Mais c’est l’intelligence hors normes de la pieuvre qu’a choisi de célébrer Adrian Tchaikovsky dans son roman Dans les profondeurs du temps. Nous avons voulu l’honorer aussi dans cet article. Publié en 2019, son livre nous plonge dans un futur où, fuyant la Terre, l’humanité se lance dans la colonisation d’autres planètes. Lors de son périple à travers les étoiles, le vaisseau spatial Égéen arrive à proximité de la planète Damas, en majorité océanique. Décision est prise de la terraformer. Un des membres de l’équipage scientifique, Disra Senkovi, modifie alors génétiquement des pieuvres pour en faire des ingénieurs sous-marins aux services des humains. Mais, grâce à leur grande intelligence, les pieuvres développent leur propre civilisation sur ce nouveau monde…
« Les octopodes connaissaient [Senkovi] ; ils lui rendaient parfois visite en remontant dans le puits gravitationnel de l’ascenseur qui constituait l’amarre permanente de l’Égéen, maintenant géostationnaire. Ils avaient aménagé des canaux dans les entrailles du vieux vaisseau, jusqu’à la cuve centrale, ce qui leur permettait de flotter devant Senkovi et d’observer ce prodige vertébré. Leur peau clignotait, fluctuait, et ils adoptaient des poses élaborées, torsadées, comme s’ils dansaient pour lui » – extrait du livre.
Pourquoi l’intelligence des pieuvres nous fascine-t-elle tant ? Sans doute parce que les céphalopodes manifestent des comportements intelligents qui étonnent par leur sophistication. Mais aussi parce qu’ils les réalisent selon des schémas fort distincts du cerveau humain.
La pieuvre dispose d’un gros cerveau : celui-ci contient environ 500 millions de neurones
Changements de pigmentation d’une pieuvre observés pendant son sommeil © Nature on PBS / Passion Planet Ltd
Pour comprendre cela, une présentation rapide d’Octopus vulgaris s’impose. Au vu de sa taille globale, la pieuvre dispose d’un gros cerveau : celui-ci contient environ 500 millions de neurones, autant que le chien [1]. L’organisation de ce cerveau a peu à voir avec le nôtre. En effet, il n’est pas totalement localisé dans la tête de l’animal mais comporte des extensions – appelées « cordes neurales » dans le jargon scientifique – qui se trouvent distribuées à travers ses bras. Question capacités cognitives, on sait que le céphalopode est capable d’analyser des stimuli sensoriels, de mémoriser et d’apprendre. Considérées comme prérequis à la réalisation de tâches cognitives complexes, telles que la planification, l’anticipation, le raisonnement et l’imagination, ces aptitudes attestent du potentiel intellectuel de l’invertébré [2].
En outre l’animal a huit bras flexibles et non pas deux comme nous. Lorsque la pieuvre explore les fonds marins, avec ses ventouses, c’est autant de possibilités pour se saisir d’objets. Or, ces objets, elle est capable de s’en servir comme des outils ! Observé en milieu naturel et signe de grande intelligence, cette capacité est rare dans le monde animal. Le club très fermé des espèces qui en sont dotées comprend les primates, les dauphins et les corbeaux [2]. Plus étonnant encore, les bras du poulpe sont capables d’agir de façon autonome grâce à son cerveau distribué : la zone qui, dans la tête de l’animal, est connectée à son bras n’a pas besoin d’être sollicitée [3]… Non, il ne s’agit de science-fiction (pour le coup), on parle bien ici d’observation scientifique.
D’aucuns n’hésitent pas à affirmer que la pieuvre a neuf cerveaux plutôt qu’un seul.
Avec ces capacités cérébrales uniques, on dit souvent de la pieuvre qu’elle possède une intelligence « extraterrestre » : ce terme a-t-il été un déclic pour Adrian Tchaikovsky, lorsqu’imaginant son histoire, il décida que les terraformeurs de Damas se feraient aider de pieuvres pour bâtir leurs infrastructures sous-marines ?
Octopus vulgaris a une neuroanatomie atypique : elle a un cerveau « distribué ». D’aucuns n’hésitent pas à affirmer que la pieuvre a neuf cerveaux plutôt qu’un seul. Regardons cela d’un peu plus près. La tête de la pieuvre renferme un cerveau qui, s’il contrôle classiquement les fonctions centrales de l’animal (comme la régulation des fonction vitales, l’intégration sensorielle ou la gestion du sommeil) comporte huit prolongements : un dans chaque bras (voir schéma). Chaque prolongement forme une unité distincte gérant les fonctions du bras. « Huit bras doués d’autonomie + une tête = neuf cerveaux », le raccourci est rapide. D’ailleurs côté SF, sur Damas, les pieuvres super-évoluées sont conscientes de cette distribution cérébrale et aiment à la préciser : elles utilisent ainsi le terme de « domaine » pour désigner la partie du cerveau qui occupe la tête et le terme de « couronne » pour l’ensemble des huit prolongements présents dans les bras.

Fait remarquable, la « couronne » de la pieuvre contient près des deux tiers des neurones du céphalopode, soit la grande majorité. Cet équipement neuronal, associé à une structure musculaire sans squelette, permet au céphalopode de réaliser de nombreux comportements à l’aide de ses bras. Lors de ses explorations sous-marines, la pieuvre se déplace et touche son environnement, ce qui lui donne l’occasion de le sentir ou de le goûter. La pieuvre se nettoie, chasse, utilise des outils – on le rappelle – et construit des abris [2,4].
Une fois mis en action, les bras remplissent leur tâche en toute liberté.
Si les bras peuvent en outre agir de façon autonome, c’est que chacun d’entre eux possède son propre centre moteur pour réaliser des mouvements et les contrôler. Chez les vertébrés, ces centres se trouvent dans le cerveau. Observation amusante : un bras de pieuvre amputé est capable de se déplacer et de réaliser la plupart des comportements observés avant amputation !
Laissant libre court à son imagination, Adrian Tchaikovsky voit plus loin que les faits scientifiques en dotant chaque bras de pieuvre habitant Damas d’un esprit. Grâce à lui, chaque bras peut exécuter des tâches indépendamment des sept autres, et surtout du « domaine ». Les bras opèrent des travaux de réparation différents et font même des calculs. Mais, n’en déplaise aux tenants de l’idée « des neuf cerveaux », quoiqu’autonomes, les bras de la pieuvre ne sont pas totalement indépendants du cerveau.
Une fois mis en action, les bras remplissent leur tâche en toute liberté. Lors de la locomotion par exemple, on sait que la coordination de leurs mouvements peut se faire sans l’intervention du cerveau : l’existence de connexions neurales reliant entre eux les prolongements neuraux brachiaux rend cela possible. Lors d’un comportement de chasse toutefois, la pieuvre doit adapter les actions de ses bras en fonction des informations visuelles qu’elle reçoit [5]. Le cerveau est dans ce cas sollicité en parallèle. Dans quelles situations les bras sont-ils parfaitement autonomes ? Ou, au contraire, sont-ils activés par une commande en provenance de la tête ? Les connaissances scientifiques ne le renseignent pas de façon exhaustive.

Les situations d’apprentissage donnent lieu aussi à des observations intéressantes. Grâce à la présence de son centre moteur et à celle d’une grande densité de neurones brachiaux, un bras est capable de traiter localement l’ensemble des informations neuronales reçues lors de l’exécution d’une tâche. Et de la sorte d’apprendre par lui-même. Mais ce n’est pas tout. On a pu observer en laboratoire qu’un bras, n’ayant jamais été sollicité pendant une phase d’apprentissage, pouvait reproduire le comportement appris par un autre bras (ie en laboratoire, après plusieurs essais, on a appris à un bras à rebrousser chemin si la surface de labyrinthe qu’il explore est lisse, or un bras n’ayant jamais été exposé au labyrinthe fait demi-tour immédiatement lorsqu’à la première exploration il rencontre une surface lisse). Ce qui signifie que l’information apprise par un bras peut être transmise aux sept autres. Cette transmission de savoir se fait-elle directement ? Ou bien nécessite-t-elle au préalable un archivage par le cerveau qui redistribue l’information en cas de besoin ? [6].
Les neurobiologistes ne comprennent pas bien aujourd’hui comment se déroule l’intégration des informations en provenance des huit bras et de la tête. Les études chez les vertébrés semblent montrer que le recours à un seul centre de traitement est le moyen le plus efficace pour ce faire. Comment le céphalopode procède-t-il donc ? Répondre à cette question est un réel défi car mesurer les réponses cellulaires du cerveau de la pieuvre est, du fait de son corps mou et de son mode de vie aquatique, très compliqué… Mais passionnant. En connaître davantage sur le fonctionnement cérébral de la pieuvre, c’est aussi mieux connaître le nôtre et s’offrir l’occasion de potentielles découvertes en robotique [7].
Sur Damas, la « couronne » des pieuvres d’Adrian Tchaikovsky évolue et devient capable de réaliser des calculs complexes et de stocker un grand nombre de données à la demande du « domaine ». Un super ordinateur en somme… Non, que ce soit dans nos océans ou dans les pages d’un livre de science-fiction, les bras des céphalopodes n’ont vraiment rien de commun avec les nôtres.
Pour en découvrir davantage… Parcourez les autres articles dédiés à la SF !
Quand la science-fiction interroge les neurosciences
Recours aux neurotechnologies, manipulation de la mémoire et de nos sens, prise de contrôle sur les rêves, interactions avec l’intelligence artificielle, exploration d’intelligences animales surprenantes… Comment la SF s’empare-t-elle des avancées en neurosciences ? > Lire notre série
Références
[1] Binyamin Hochner (2012). An embodied view of octopus neurobiology. Current Biology 22, R887-892.
[2] Alexandra K. Schnell, Piero Amodio, Markus Boeckle & Nicola S. Clayton (2021). How intelligent is a cephalopod, lessons from comparative cognition. Biological Reviews 96, 162-178.
[3] Guy Levy, Tamar Flash & Binyamin Hochner (2015). Arm coordination in octopus crawling involves unique motor control strategies. Current Biology 25, 1195-1200.
[4] Cassady S. Olson & Clifton W. Ragsdale (2023). Toward an understanding of octopus arm motor control. Integrative and Comparative Biology 63, 1277-1284.
[5] Scott L. Hooper (2020). Operant learning, octopus arms need brains to learn their way. Current Biology 30, R1301-1330.
[6] Tamar Gutnick, Letizia Zullo, Binyamin Hochner & Michale J. Kuba (2020). Use of peripheral sensory information for central nervous system of arm movement by Octopus vulgaris. Current Biology 30, 4322-4327.
[7] Dominic M. Sivitilli, Joshua R. Smith & David H. Gire (2022). Lessons for robotics from architecture of the octopus. Frontiers in Robotics and AI 9, 862391.