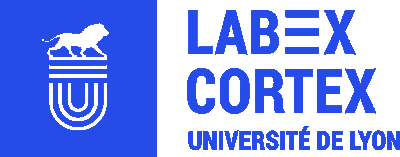S’inspirant du transhumanisme, le scénariste de Severance a imaginé une intervention chirurgicale proche de celles qui sont utilisées aujourd’hui pour soulager certains malades. C’est surtout la question du rôle de la mémoire dans la construction de la personnalité qu’il fait émerger.
Quand des œuvres de science-fiction interrogent les neurosciences : épisode #5.
Crédit photo image centrale © Apple TV+
Dans la série Severance, diffusée avec succès au premier semestre, les employés de Lumon Industries sont dissociés entre leur « moi du boulot » et le « moi de la maison ». Le premier peut se consacrer entièrement à ses tâches professionnelles, sans être gêné par les aléas de la vie quotidienne, tandis que le second vaque librement à sa vie privée sans la charge mentale et les contrariétés dues au travail. Portée à l’écran, cette vision d’un esprit dissocié n’est pas réservée à la science-fiction. Elle s’inspire de cas réels… pathologiques pour la plupart.
On peut citer à ce titre le trouble dissociatif de l’identité, appelé anciennement trouble de la personnalité multiple. Cette maladie psychiatrique chronique, sujette régulièrement à des fantasmes cinématographiques (dont Secret window en 2004 avec Johnny Depp, ou Split en 2017 avec James Mc Avoy) se caractérise par l’alternance entre différentes personnalités, chacune possédant une mémoire et une histoire qui lui est propre. Mais cette image popularisée par la fiction reste simpliste, car dans la pratique clinique, les identités ne sont pas toujours aussi nettement séparées, et les frontières peuvent être très floues et nuancées.
Il est question d’esprit dissocié aussi lorsqu’on évoque le stress post traumatique. Dans ce cas, les souvenirs associés à une expérience traumatisante sont possiblement fragmentés voire totalement oubliés : on parle d’amnésie dissociative. Celle-ci est souvent liée à des échanges altérés entre plusieurs structures du cerveau dont l’hippocampe, liée à la mémoire épisodique, l’amygdale (mémoire émotionnelle) et le cortex préfrontal qui régule globalement la cognition et qui réprime activement les souvenirs intrusifs [1]. Dans ce contexte traumatique, le cerveau est donc capable de compartimenter une partie de sa mémoire afin de continuer à fonctionner.
Prenant le parti pris inverse, Severance nous invite à envisager une dissociation de la mémoire au prime abord bénéfique pour l’être humain. Qu’elle puisse être l’opportunité pour tout salarié – ou toute personne active – d’améliorer ses performances au travail ! Dans la série, les employés dissociés de l’entreprise Lumon ont pour mission d’effectuer des tâches de « raffinement de macro-données ». Quoique cet exercice ait peu de sens, peu importe. Le but, clair pour tout le monde, est de réaliser 100% des tâches demandées dans la joie et la bonne humeur. Et, pour Mark, héros de la série, avoir un esprit dissocié apparaît avantageux alors que sa vie affective vient d’être bouleversée par la perte d’un être cher.
Le prix à payer pour les employés est le renoncement à leurs souvenirs personnels.
Navigant dans un univers dystopique, les personnages de la série nous renvoient à une obsession contemporaine, celle de « l’humain augmenté ». Selon cette idée, dépasser les limites physiologiques du corps humain pour concevoir un être amélioré, plus rapide, plus précis, devient désirable. Défendu par les adeptes du transhumanisme, et envisageable grâce au progrès en neurotechnologie, ce dépassement est loin de faire l’unanimité dans la communauté scientifique qui, de façon constante, appelle à la vigilance.
On ne sait que peu de choses en effet des conséquences à long terme d’une augmentation des capacités humaines. D’autant que, si elle a lieu, celle-ci a un coût. Quid des risques pour la santé (AVC, infections…) ou de l’éthique (perte d’autonomie, libre arbitre de l’individu) [2] ? Dans Severance, le prix à payer pour les employés est le renoncement à leurs souvenirs personnels, ainsi que l’acceptation d’une forme de déshumanisation. Helly, l’un des personnages clés de la série, n’arrive plus à se rappeler son prénom, ni la couleur des yeux de sa mère par exemple.
Projetons-nous dans l’inconnu. Et si une opération permettant de dissocier deux formes de mémoire grâce à l’implantation d’une puce électronique dans le cerveau était possible, où faudrait-il opérer ? Dans Severance, la profondeur et la localisation de la sonde chirurgicale lors de l’opération suggèrent que la puce se situe au niveau de l’hippocampe.
Des technologies similaires à celle évoquée dans Severance sont utilisées aujourd’hui à des fins thérapeutiques.

Une fois la puce implantée à cet endroit, son rôle pourrait-il être – à l’image de ce que vit Mark – celui d’un interrupteur activant la mémoire personnelle de l’individu, ou bien sa mémoire professionnelle, selon le l’endroit où il se situe ? Cette proposition de la série est peu concevable car la mémorisation est un processus complexe qui met en jeu de nombreuses opérations impliquant d’autres aires cérébrales et d’autres structures neuroanatomiques que l’hippocampe. Ce dernier ne fonctionne pas seul. En plus du cortex préfrontal et de l’amygdale déjà mentionnés, le cortex pariétal et le cortex temporal jouent un rôle clé par exemple dans la mémoire sémantique – celle des mots et des connaissances sur le monde – et perceptive – permettant la reconnaissance inconsciente des objets. Mémoriser mobilise encore d’autres fonctions cognitives comme l’attention ou les émotions. Tout n’est pas si simple…
Soulignons au passage un fait important : des technologies similaires à celle évoquée dans Severance sont utilisées aujourd’hui à des fins thérapeutiques pour soulager des patients affectés par des maladies neuropsychiatriques et qui sont réfractaires aux traitements traditionnels. Et ces procédés sont fascinants !
Ainsi en 2011, Brandy Ellis, une trentenaire américaine souffrant de dépression sévère s’est vu poser un implant ciblant une zone profonde de son cortex préfrontal. Supervisée par la neurologue Helen Mayberg, célèbre pour les travaux ayant rendu possible la procédure d’implantation[3], l’intervention chirurgicale s’est déroulée sous anesthésie locale pour permettre à l’équipe médicale d’interagir avec Brandy pendant les six heures d’opération. Comprenant entre autres une électrode placée au niveau d’une zone appelée « CG25 », l’implant délivre en continu une stimulation électrique haute fréquence qui module l’activité neuronale de la région. Peu de temps après l’intervention, les symptômes dépressifs sévères de Brandy Ellis se sont atténués. Un résultat inespéré, alors que l’Américaine s’était montrée résistante à une vingtaine de traitements auparavant.
Les effets de ces techniques de stimulation cérébrale [..] sont réversibles la plupart du temps.
Une autre technique, encore au stade de recherche, consiste à stimuler le cerveau afin de ralentir la perte de mémoire causée par la maladie l’Alzheimer. N’utilisant pas d’implant, donc moins invasive, celle-ci repose sur une stimulation magnétique transcrânienne et répétitive du precuneus, une petite région de la face interne du lobe pariétal impliquée dans les troubles de mémoire précoces associés à la maladie [4].
Les effets de ces techniques de stimulation cérébrale, qui reposent sur la capacité des synapses à créer de nouvelles connexions et sur la modulation de l’activité des neurones, sont réversibles la plupart du temps. Des séances d’entretien ou de recalibration sont nécessaires pour en maintenir l’efficacité. Une contrainte dont la série s’affranchit allègrement ! Ce qui est sans doute préférable pour le spectateur.
Enfin, Severance met en lumière, le rôle de la mémoire dans la construction de la personnalité, ce qui est un point fondamental en neurosciences. Nous sommes qui nous sommes grâce à trois composantes de notre mémoire : la mémoire autobiographique, la mémoire émotionnelle et la mémoire implicite. La première nous permet d’assurer la continuité de notre identité et donner du sens à notre vie. La seconde, qui enregistre les événements marquants, influence profondément nos traits de personnalité, tels que l’anxiété ou la confiance en soi. Quant à la dernière, elle façonne nos comportements et réactions sans que nous en ayons conscience.

Dans la série, on constate que l’amnésie entre les identités professionnelles (innies) et personnelles (outties) des personnages affecte profondément leur personnalité. Leurs attitudes diffèrent radicalement selon l’état innie ou outtie, où ils se situent. Ainsi, d’après son ami Petey, la voix Mark se modifierait dès qu’il passe à l’extérieur de Lumon. De même, les autres personnages révèlent des passions et des aspirations contrastées selon qu’ils sont au travail ou en dehors.
En s’alimentant de notre passé, notre mémoire façonne notre présent.
Illustrant cette problématique, les patients atteints de schizophrénie souffrent parfois de dépersonnalisation, avec un sentiment d’irréalité. Il leur arrive de ne plus savoir se reconnaitre ou reconnaitre leurs proches. Des thérapies associant des psychothérapies cognitives appliquées à la mémoire autobiographique, sont étudiées aujourd’hui pour les aider : on les incite à recouvrer des souvenirs autobiographiques en lien avec leurs histoires personnelles, pour servir de point d’ancrage favorisant la cohérence de leurs pensées et la stabilité de leur identité[5].
S’appuyant sur le modèle Self-Memory System[6], les chercheurs envisagent notre mémoire comme une boîte stockant nos expériences passées, certes, mais dont les souvenirs peuvent être mobilisés avec une tonalité différente selon les circonstances du moment.
Pour plus de clarté, imaginons que vous postuliez à un emploi conditionné par une bonne maîtrise des mathématiques, par exemple. Or, il y a longtemps, vous avez échoué à un concours dans cette discipline. La façon avec laquelle vous réactiverait ce souvenir dépendra de votre humeur au moment où vous vous réfléchissez à la décision à prendre. Il y a au moins deux scénarios possibles : dans l’un, vous vous focalisez sur votre échec passé, et il est fort probable que vous estimiez ne pas avoir les qualifications requises pour le poste. Dans l’autre, vous valorisez cette expérience, en vous rappelant que vous aviez terminé à la deuxième place (tout de même), et vous vous présentez sous votre meilleur jour pour obtenir le poste de vos rêves. Il est une certitude. En s’alimentant de notre passé, notre mémoire façonne notre présent et contribue à modeler notre avenir.
Severance parle à chacun d’entre nous : qui n’a jamais rêvé d’appuyer sur un bouton et d’oublier tout ce qui lui pèse, au travail comme à la maison ? Sans doute est-ce là une raison de son succès. Au-delà des questions éthiques liées aux neurotechnologies, Severance interroge notre rapport au travail et la place qu’il occupe dans nos vies quotidiennes. Puisque nos expériences nous façonnent, à nous de les choisir consciemment.
Pour en découvrir davantage… Parcourez les autres articles dédiés à la SF !
Quand la science-fiction interroge les neurosciences
Recours aux neurotechnologies, manipulation de la mémoire et de nos sens, prise de contrôle sur les rêves, interactions avec l’intelligence artificielle, exploration d’intelligences animales surprenantes… Comment la SF s’empare-t-elle des avancées en neurosciences ? > Lire notre série
Références
1. Alexandra Kredlow M, Fenster RJ, Laurent ES, Ressler KJ, Phelps EA. Prefrontal cortex, amygdala, and threat processing: implications for PTSD. Neuropsychopharmacology. 2022 Jan;47(1):247-259.
2. Actualité Inserm : L’humain augmenté, un futur souhaitable ?
3. Mayberg HS, Lozano AM, Voon V, McNeely HE, Seminowicz D, Hamani C, et al. Deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Neuron. 3 mars 2005;45(5):651‑60.
4. Koch G, Bonnì S, Pellicciari MC, Casula EP, Mancini M, Esposito R, et al. Transcranial magnetic stimulation of the precuneus enhances memory and neural activity in prodromal Alzheimer’s disease. NeuroImage. 1 avr 2018;169:302‑11.
5. Berna F, Potheegadoo J, Allé MC, Coutelle R, Danion JM. [Autobiographical memory and self-disorders in schizophrenia]. L’Encephale. févr 2017;43(1):47‑54.
6. Conway MA, Pleydell-Pearce CW. The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychol Rev. avr 2000;107(2):261‑88.