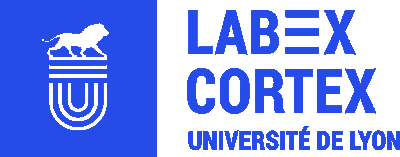Partager les rêves d’autrui pour en dévoiler les secrets et accéder à son inconscient a inspiré des films comme Paprika de Satoshi Kon, ou Inception de Christopher Nolan. Selon Perrine Ruby du CRNL, cet imaginaire traduit un autre fantasme : celui d’accéder aux pensées d’un individu en lisant son activité cérébrale.
Quand des œuvres de science-fiction interrogent les neurosciences : épisode #3
Crédit photo image centrale © Shutterstock_Gorodenkoff
Avez-vous la bosse des maths ? Si vous avez haussé le sourcil d’un air sceptique en entendant cette expression, vous avez étiré sans le savoir ladite zone puisque, selon le neurologue Franz Joseph Gall, cette bosse se situait non loin de l’arcade sourcilière. Père de la phrénologie, ce médecin allemand du 19e siècle estimait que les facultés mentales et affectives d’un individu étaient conditionnées par la forme de son crâne : il suffisait de voir (ou de tâter) pour les déterminer. La phrénologie a séduit pendant 30 ans par sa relative praticité puis, vers 1840, elle a été ravalée au rang de pseudo-science. Pas si simple en fait d’accéder à la complexité du fonctionnement du cerveau humain.
Un siècle et demi plus tard, l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) permet d’enregistrer des variations de débits sanguins dans le cerveau, un bien meilleur indicateur de son fonctionnement que sa forme ou son anatomie. L’usage de l’IRM a révolutionné le champ des neurosciences, en permettant des mesures de l’activité cérébrale à un moment donné pendant une tâche donnée. Mais, la mesure reste grossière, et il ne faudrait pas surinterpréter ses images au risque de tomber dans une nouvelle forme de phrénologie. On ne peut pas aujourd’hui, par exemple, se contenter de l’IRM pour déceler la preuve d’un comportement déviant ou celle d’un mensonge. On aimerait que les images IRM, ou les enregistrements électrophysiologiques, permettent de décrypter émotions, motivations et pensées, mais le peuvent-elles vraiment ?!

C’est avec cette vision à l’esprit que de nombreux scénaristes de SF ont exploré l’idée d’un « lecteur de cerveaux » : un objet plus ou moins futuriste – un casque en somme – permettant d’enregistrer mais aussi d’expérimenter le vécu par procuration. Ce fantasme a été mis en scène avec brio par Kathryn Bigelow dans le film Strange Days, sorti en 1995. Se situant dans un monde post-apocalyptique, ce thriller propose de suivre l’évolution de Lenny Nero, un trafiquant de vidéos offrant l’occasion de revivre n’importe quelle situation à la place d’autrui. Des moments riches en sensations agréables ou redoutables de cruauté en fonction du scenario choisi.
« Les neurosciences continuent à porter en elles ce fantasme d’accéder à ce que voit, ressent et pense un individu à partir de mesures de l’activité cérébrale», commente Perrine Ruby, chercheuse au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et spécialiste de l’étude des rêves. Au-delà du seul décodage de l’activité cérébrale, dans les œuvres SF, il serait encore question d’hacker le contenu du cerveau et d’en prendre le contrôle. « Cette idée de prise de pouvoir sur l’esprit – qui reflète assez logiquement le mode de pensée capitaliste dans lequel nous baignons – est flagrante quand on regarde des œuvres de science-fiction abordant le rêve comme Inception ou Paprika », poursuit la scientifique.
Aidez la recherche !
En racontant votre prochain rêve dans cette enquête de l’Inserm :
>>> https://form.crnl.fr/index.php/168266?lang=fr
Les données sont anonymes. Un très grand merci pour votre contribution !
Salué à la Mostra de Venise en 2006, le film d’animation surréaliste Paprika, du Japonais Satoshi Kon, relate l’invention de machines rendant possible l’exploration du monde des rêves à des fins thérapeutiques. Ces machines, les DC Mini, sont des casques amplificateurs qui permettent à une thérapeute (Paprika) d’accompagner la rêveuse ou le rêveur lors de ses voyages oniriques et d’en ramener des images. Grâce à elles, il est possible de sonder l’inconscient des patients pendant leur sommeil. Petite note historique : à la sortie de Paprika, l’IRM commençait à être utilisée couramment à l’hôpital et dans la recherche. Dans le film, tout se passe bien jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’un être malveillant s’introduit par effraction dans les rêves des personnages pour y asseoir son emprise. Rêve et réalité se confondent bientôt…
Quatre ans plus tard, Christophe Nolan reprend le concept dans Inception : il est question cette fois-ci d’avoir recours au rêve partagé pour satisfaire des objectifs d’espionnage industriel. La méthode (sans casque) permet à un « extracteur » de s’introduire dans le rêve d’une victime pour y voler des informations sensibles stockées dans le subconscient. « Mon sentiment est que si des scientifiques pouvaient vraiment voir le rêve de quelqu’un en direct alors que la personne sommeille – ce qui me semblerait profondément indécent –, notre conscience endormie pratiquerait une censure et ne rêverait pas comme d’habitude » indique Perrine Ruby.
En effet, pendant que nous rêvons, notre conscience n’est pas totalement éteinte. Selon la chercheuse, l’équivalent d’une « conscience inconsciente » subsisterait, qui nous permettrait de garder du lien avec l’extérieur, et de veiller aussi sur notre monde intérieur. Nous faisons l’expérience de cette forme particulière de conscience lorsque nous nous réveillons spontanément avant la sonnerie du réveil ou lorsque nous nous réveillons avant qu’un cauchemar ne tourne trop mal. Les oscillations et mélanges entre l’inconscient du rêveur et sa conscience sont maximum au cours des rêves dits lucides (rêves au cours desquels on prend conscience d’être en train de rêver), un phénomène connu depuis l’Antiquité mais étudié scientifiquement à partir des années 1980.
La personne qui rêve et ses personnages sont connectés.
En 2014, dans une publication de la revue Dreaming, des travaux de chercheurs allemands ont ainsi montré que lors d’un rêve lucide, la personne qui rêve et ses personnages sont connectés. Leur expérimentation est surprenante : à la demande des scientifiques, des « moi » de rêveurs lucides se sont adressés aux protagonistes de leurs rêves pour leur demander de deviner un nombre de doigts que les sujets rêvant cachaient derrière leur dos. Le nombre de réponses justes données par les personnages s’est révélé au -dessus du niveau d e la chance. Et le jeu de devinette fonctionne dans le sens inverse, c’est-à-dire si c’est le « moi » du rêveur qui devine. Les volontaires retranscrivaient le déroulé de l’expérience sur papier à leur réveil. Ces résultats montrent que, en rêve, on peut se faire croire qu’on ne sait pas (le personnage qui devine a l’impression de ne pas savoir), alors que en fait on sait (c’est notre cerveau qui a décidé le nombre le doigt caché dans le dos) !
De tels récits oniriques constituent l’outil de travail favori de Perrine Ruby qui investigue comment le rêve aide les individus à réguler leurs émotions. La régulation émotionnelle est l’une des hypothèses formulées par la communauté scientifique quant au rôle fonctionnel du rêve. « Dans l’intimité de notre sommeil, nous revivons les situations de la journée et les émotions qui les ont marquées, explique la neuroscientifique. Le travail du rêve, comme l’appelait Freud, consiste à convoquer des souvenirs et à les transformer, à représenter une émotion de manière métaphorique, ce qui permet soit la prise de conscience d’une émotion soit de la comprendre ou de l’expérimenter autrement ».
Le rêve est un moyen pour la personne qui rêve d’exprimer ses émotions sans censure.
Lors d’une étude faite au laboratoire, la chercheuse et son équipe ont montré que le rêve permet une relative neutralisation émotionnelle de nos souvenirs : la version rêvée de souvenirs se révèle moins intense que la version vécue à l’éveil. Pour accomplir son travail, le rêve utilise un outil puissant, la métaphore, qui est un moyen pour le rêveur d’exprimer ses émotions sans censure ni gêne, c’est-à-dire telles qu’elles sont ressenties. Ces métaphores se traduisent par des représentations symboliques très fines comme, par exemple, l’image d’une vague, d’un tsunami, alors que dans la vie on s’est senti dépassé par des évènements. Ce rêve a été beaucoup fait au cours du 1er confinement de 2020 en France
Pour en savoir plus : Rêver pendant le confinement, EDP Science, 2021
Cette capacité remarquable du cerveau à élaborer, pendant le sommeil, des tableaux évoquant les émotions de notre vie éveillée a été portée à l’écran avec justesse par Quentin Dupieux dans son film Wrong de 2012. Dans cette comédie absurde – un style signature de l’auteur – et étrange, on suit les tribulations de Dolf, un agent de voyage au chômage à la recherche de son chien disparu. Des scènes s’enchaînent où se croisent, dans une logique non euclidienne, un palmier qui se transforme en sapin, un gourou d’animaux de compagnie qui enseigne la télépathie, une serveuse de pizzas acceptant sans question le fait que son homme change de corps, un jardinier qui se réveille – ravi de soulagement – dans un cercueil…
Pour savourer Wrong, il faut lâcher prise et se laisser porter sans chercher à comprendre. « Le travail de réalisation de Dupieux mime parfaitement le rêve et sa manière métaphorique de procéder, commente Perrine Ruby. Lorsqu’il met en scène le monde professionnel de Dolf, représenté par des bureaux dans lesquels il pleut, ce qui est tu, ce qui est tabou – comment le monde du travail malmène – devient visible, sensible ». Bien qu’il ait été licencié, Dolf revient travailler sous la pluie avec ses collègues, qui le regardent d’un mauvais oeil. Avec ses métaphores visuelles, Dupieux nous dit que c’est un luxe, un signe d’inclusion social, d’avoir le privilège de se faire malmener au travail. Dans Wrong, ce qui est en théorie inconcevable pour la conscience devient possible. « Comme dans le rêve, qui nous offre cette liberté d’accéder à notre vérité émotionnelle », conclut Perrine Ruby.
Pour en découvrir davantage… Parcourez les autres articles dédiés à la SF !
Quand la science-fiction interroge les neurosciences
Recours aux neurotechnologies, manipulation de la mémoire et de nos sens, prise de contrôle sur les rêves, interactions avec l’intelligence artificielle, exploration d’intelligences animales surprenantes… Comment la SF s’empare-t-elle des avancées en neurosciences ? > Lire notre série