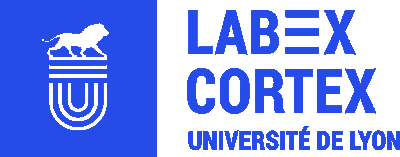La réussite du confinement repose sur une large adhésion de la population aux contraintes qui lui sont imposées. Pour cela, les sanctions en cas de non-respect des règles ne suffisent pas, il faut aussi que le fait de les transgresser soit considéré comme socialement inacceptable. La loi a-t-elle ce pouvoir ? C’est ce qu’ont voulu savoir des chercheurs en économie expérimentale en réalisant une étude pendant le premier confinement.
Avec le deuxième confinement, restreindre la vie sociale au minimum est redevenu une priorité. Pour y parvenir, le gouvernement a édicté un certain nombre de dispositions réglementaires assorties de sanctions en cas d’infraction. Est-ce suffisant pour changer les comportements ? Non, car il faut aussi modifier les « normes sociales », c’est-à-dire transformer les croyances sur ce qui est considéré comme acceptable ou non par ses pairs. C’est le rôle des campagnes d’information. Cependant, l’État, qui n’a pas les moyens de vérifier l’application des règles sanitaires dans la sphère privée, doit surtout miser sur la faculté de la loi à transformer des normes sociales acquises de longue date. Pari risqué ou judicieux ?
Cette question, peut-être aussi vieille que la politique, est plus que jamais d’actualité en économie comportementale : « Il existe un débat scientifique pour savoir si la loi modifie les croyances collectives, ou si c’est le contraire, explique Fabio Galeotti, membre du Groupe d’analyse et de théorie économique Lyon-Saint-Étienne (GATE-LSE). Une vaste littérature théorique soutient que les lois exercent un effet causal sur les normes sociales, mais il n’y a pas de tests empiriques basés sur un changement de la loi dans le monde réel. » La première vague du Covid-19 a été l’occasion pour le chercheur de vérifier si la loi avait influencé les croyances : « On a voulu savoir si les mesures de confinement modifiaient la perception des normes sociales. »
Pendant quinze semaines, 400 participants ont reçu un questionnaire hebdomadaire dans lequel ils devaient évaluer s’ils trouvaient approprié qu’une personne reçoive des amis pour un dîner.
Pour mesurer cette évolution, Fabio Galeotti et les co-autrices de l’étude – Marie Claire Villeval, directrice du GATE-Lab, et Fortuna Casoria, post-doctorante du même laboratoire – ont mené une étude sur quinze semaines, à partir de la première semaine avant le confinement. Plus de 400 participants ont ainsi reçu un questionnaire hebdomadaire dans lequel ils devaient évaluer s’ils trouvaient approprié qu’une personne reçoive des amis pour un dîner. « L’idée n’était pas de mesurer l’opinion personnelle mais la perception de l’opinion collective », précise Fabio Galeotti. Les deux peuvent en effet diverger : un individu peut considérer à titre personnel qu’un dîner entre amis est acceptable malgré la pandémie et sentir en même temps que ce comportement serait mal vu par autrui (car il dérogerait à la norme sociale). Pour recueillir cette perception, l’équipe s’est appuyée sur une méthode mise au point par les professeurs en économie comportementale Erin Krupka et Roberto Weber. Elle consiste dans ce cas à demander aux sondés comment la majorité des répondants jugera cette idée de dîner entre amis. Et, pour stimuler leur perspicacité, on leur propose de l’argent si leur réponse est la même que celle de la majorité des répondants.
Grâce à cette technique, l’enquête montre que la loi renverse bien la norme sociale existante : « Cela n’avait pourtant rien d’évident, souligne Fabio Galeotti. En effet, des études antérieures avaient révélé que les normes sociales sont tenaces. » Dès la mise en place des mesures contraignantes, les participants ont majoritairement considéré qu’un dîner entre amis est perçu comme « socialement inapproprié » par autrui. Cela ne signifie pas que tous ont scrupuleusement suivi les règles du confinement. Mais ils anticipaient que, en les violant, non seulement ils prenaient le risque d’une amende, mais ils s’exposaient aussi à des sanctions morales et sociales de leur comportement. « Sans changement de la norme, la seule introduction de la loi aurait certainement eu un effet beaucoup plus faible, et l’efficacité du confinement aurait été moindre, estime Marie Claire Villeval. Le risque de se faire verbaliser et le montant de l’amende ne sont pas suffisamment élevés pour dissuader. » Autre enseignement : le fait de légiférer a pesé beaucoup plus sur la perception de la norme sociale que l’estimation du risque de contamination. « La nouvelle norme perçue est restée stable, même si en parallèle le risque sanitaire perçu pour soi-même diminuait au fur et à mesure du confinement », remarque Fabio Galeotti.
“ L’information sur les risques sanitaires est essentielle mais pas suffisante pour générer cet effet sur l’évolution des normes de comportement, et ce d’autant plus que les experts ont parfois émis des avis divergents. ”
Cette étude montre aussi la puissance normative de la loi par l’analyse de la sortie du confinement. Aussitôt le déconfinement décidé, le même dîner entre amis redevient perçu comme « socialement approprié » : la pression sociale est levée. Que peut-on en conclure ? Pour Marie Claire Villeval, « des mesures législatives sont certainement nécessaires pour générer l’adaptation des normes sociales, puisqu’on voit que la perception de la norme revient très vite à son point de départ dès qu’on lève les contraintes. » En outre, ce retour à cet état d’avant le confinement s’est opéré malgré les allocutions gouvernementales et les mises en garde. « Dans nos données, on voit que les discours n’ont pas eu d’impact additionnel sur la perception de la norme sociale », indique Fabio Galeotti. C’est peut-être un des facteurs qui explique la deuxième vague. Pourtant, il ne faut pas en conclure que les discours n’ont aucune portée : « Le discours politique informe, coordonne les croyances, mobilise, mais il est aussi mis en doute, fait remarquer Marie Claire Villeval. L’information sur les risques sanitaires est essentielle mais pas suffisante pour générer cet effet sur l’évolution des normes de comportement, et ce d’autant plus que les experts ont parfois émis des avis divergents. »
Quelle leçon peut-on tirer de cette étude ? Sans doute peut-on la lire comme un avertissement en vue de la sortie du reconfinement. « Lors du premier déconfinement, la norme sociale aurait dû se stabiliser à un niveau inférieur pour assurer une lutte plus efficace contre l’arrivée de la seconde vague. Les discours n’ont pas été suffisamment entendus pour changer la perception de ce qu’il est approprié de faire ou pas face au risque de contamination », regrette Marie Claire Villeval. Bref, si la norme sociale revient à l’ordinaire avant qu’un vaccin soit disponible, le scénario pourrait se reproduire.