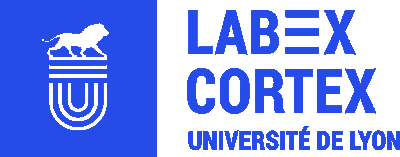Une lésion neurologique peut-elle déterminer un comportement criminel ? Telle est la question que peut se poser aujourd’hui un tribunal en France. Et, depuis 2011, il peut recourir à l’imagerie cérébrale pour y répondre. Bien que rarement utilisée, cette possibilité interroge aussi bien les juristes que les neuroscientifiques. (Croquis d’audience : Sylvie Guillot.)
L’affaire se déroule à Lyon, en 2014, à l’occasion du procès en assise de Sébastien C., accusé de « coups mortels ». Les faits remontent à 2007, lors d’une bagarre l’ayant opposé à un autre pensionnaire du foyer pour personnes en grande difficulté où il vivait à l’époque. L’accusé frappe violemment son compagnon d’infortune, qui, pour lui échapper, enjambe une balustrade et s’écrase deux étages plus bas. Une expertise psychiatrique est commandée. Elle ne révèle aucun trouble mental pouvant atténuer la responsabilité de Sébastien. La défense demande alors à deux neuropsychiatres d’éplucher son dossier médical. Ceux-ci diagnostiquent un « syndrome frontal » lié à l’ablation, à 12 ans, d’une tumeur au cerveau ayant entraîné des séquelles épileptiques. Ils y voient la cause principale de son impulsivité et l’estiment irresponsable de ses actes. Cependant, la Cour, sur la base d’une contre-expertise, ne les suit pas. L’accusé sera finalement condamné… à une simple amende, la causalité entre l’agression et la mort n’ayant pas été démontrée.
L’intérêt de cette histoire ? Elle réside dans l’irruption, aux côtés des expertises psychologiques et psychiatriques, de données tirées des neurosciences dans un procès criminel. Encore exceptionnel en France, le fait est courant aux États-Unis. Les avocats de la défense y sont prompts à brandir des résultats d’analyses médicales et biologiques révélant des anomalies, telle une tumeur ou un traumatisme ancien, susceptibles d’agir sur le contrôle des pulsions. Le procédé permet d’expliquer en partie le comportement déviant de leur client et d’atténuer sa responsabilité pénale. C’est ainsi que, dans certains États, des meurtres ont été requalifiés en homicides involontaires et que des réductions de peine ont été accordées à des criminels présentant des lésions cérébrales.
L’imagerie cérébrale est autorisée en justice depuis 2011
En France, on n’en est pas là. Bien que le recours à l’imagerie cérébrale dans les expertises judiciaires soit autorisé depuis 2011, les magistrats se montrent réticents à utiliser cette possibilité en matière pénale. A ce jour, « seule la mise en évidence d’une pathologie, comme une tumeur cérébrale, peut jouer à décharge dans l’évaluation de la responsabilité », précise Catherine Puigelier, professeur de droit privé à l’université Paris-Lumières, qui a codirigé un ouvrage sur la question.
Il n’empêche que le concept de « neurodroit » suscite un certain engouement depuis quelques années. Conférences, thèses et livres lui sont consacrés. Ainsi, dans son ouvrage Neuroscience et droit pénal, Peggy Larrieu, maître de conférences à l’université Aix-Marseille, s’interroge sur les perspectives ouvertes par l’imagerie cérébrale. « Peut-elle contribuer à détecter le mensonge ? A garantir la crédibilité des victimes et/ou des témoins ? A éclairer les experts psychiatres chargés de se prononcer sur la responsabilité des délinquants ? A mettre en évidence les biais cognitifs des membres d’un jury ou d’un tribunal susceptibles de compromettre l’impartialité des jugements ? A évaluer la dangerosité des individus ? » Pour la juriste, la rencontre des neurosciences et du droit pénal soulève des questionnements sans précédents sur les principes fondamentaux de la justice et du droit, sur le libre arbitre et la responsabilité individuelle. En outre, elle réactive d’anciennes controverses relatives à l’approche scientifique du phénomène criminel, opposant humanistes et déterministes.
80% des détenus ont subi un traumatisme crânien modéré
Face à ce phénomène, les experts en neurosciences affichent une prudente réserve. Dans un article paru en 2016 dans la revue Canal Psy publiée par l’Université Lumière-Lyon 2, George A. Michael, chercheur en neuropsychologie, et Roxane Royer, alors doctorante de son équipe, se sont demandé « en quoi les neurosciences [pouvaient] contribuer à saisir les subtilités de l’esprit criminel ». Aborder ces questions, rappellent-ils, suppose de connaître un minimum le fonctionnement du cerveau. Notre comportement social dépendrait schématiquement de l’équilibre entre deux pôles : l’un lié à nos impulsions émotionnelles (système limbique, avec l’amygdale), l’autre qui assure la régulation des émotions et du comportement (cortex préfrontal). De fait, une lésion du cortex préfrontal peut entraîner des comportements antisociaux, voire agressifs. De la même façon, un dysfonctionnement de l’activité amygdalienne peut altérer la perception de l’environnement et déclencher des réponses agressives inadaptées. A cet égard d’ailleurs, les études menées sur la population carcérale sont troublantes : elles révèlent en effet que près de 80% des détenus ont subi un traumatisme crânien modéré touchant les lobes frontaux. En outre, on a observé que le cortex cérébral des criminels agressifs différait, en termes d’anatomie et de fonctionnement, de celui des personnes incarcérées pour des faits non agressifs.
De là à dire que ces altérations ou spécificités cérébrales seraient responsables de la commission d’actes criminels, il y a un pas que les auteurs refusent de franchir. Le comportement humain est complexe, rappellent-ils. Il ne peut se réduire à la biologie du cerveau. Un acte agressif découle de l’interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. C’est pourquoi l’intégration de la neuropsychologie dans l’expertise judiciaire ne peut être envisagée qu’en complément des expertises psychologiques, psychiatriques et sociales déjà utilisées.
Un nouveau champ de recherche : la « criminalistique cognitive »
Alors, comment savoir s’il est ou non pertinent de prendre en compte les antécédents neurologiques d’un individu ayant commis un acte criminel ? George A. Michael propose simplement de se pencher sur le passé de l’accusé. « Prenons un individu d’une trentaine d’année accusé d’homicide à la suite d’une bagarre, suggère-t-il. Si l’on découvre dans son dossier médical qu’il a été victime à 20 ans d’un accident de moto qui l’a laissé plusieurs semaines dans le coma et a provoqué des lésions cérébrales, et qu’à la suite de cet accident son comportement social a changé de manière permanente, alors, oui, on pourra considérer que son statut neuropsychologique mérite d’être pris en compte pour établir son degré de responsabilité. » Si, malgré sa lésion, son comportement n’a pas été durablement modifié, la réponse sera moins catégorique. « C’est la continuité du statut neuropsychologique entre le moment de la lésion cérébrale et le moment de l’acte socialement répréhensible qui constitue l’argument le plus convaincant quant au rôle de la cette lésion dans l’acte criminel », conclut-il.
Mais la neuropsychologie n’apporte pas seulement de nouveaux outils d’expertise judiciaire. Elle s’intéresse aussi, plus largement, à la cognition et au comportement des principaux acteurs du monde judiciaire : agresseurs, mais aussi témoins, victimes et experts. Cette approche s’appelle la « criminalistique cognitive ». C’est l’un des axes de recherche de George A. Michael (lire son interview). Avec l’aide d’un doctorant, Romain Bet (lire son interview), il cherche à établir des liens entre les traits de personnalité d’individus ayant commis des actes violents, leur profil cognitif et le passage à l’acte. L’objectif à terme étant de mettre au point des méthodes permettant de réduire la récidive. Mais on en est encore loin, tempère le chercheur : « Il ne faut pas créer d’attentes trop fortes, prévient-il. Et ce n’est pas simple. En matière de sécurité, la société attend des réponses directes, or les sciences cognitives ne les apporteront pas.