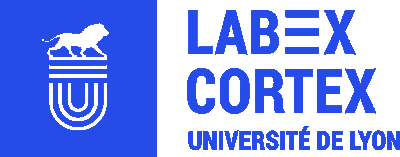On nous a appris à nous méfier de nos émotions. Elles nous souffleraient de mauvaises solutions, nous pousseraient à la faute. Mieux vaudrait s’en remettre à notre raison, surtout quand il s’agit de se projeter dans l’avenir. Ce préjugé a été récemment mis à mal par des chercheurs américains qui ont montré que nous aurions intérêt à être plus à l’écoute de notre intuition pour améliorer la qualité de nos prévisions.
Longtemps opposée à la froide rationalité et considérée – à tort – comme l’apanage des femmes, l’intuition est en passe d’être reconnue comme digne d’intérêt parles neurosciences ensemble des sciences qui s’intéressent à l’anatomie et au fonctionnement du système nerveux ensemble des sciences qui s’intéressent à l’anatomie et au fonctionnement du système nerveux . Cette faculté de l’esprit, qui permet instantanément de prendre une décision, de comprendre une réalité complexe ou de deviner les intentions de son interlocuteur, ne serait donc pas si irrationnelle que cela. On sait depuis les travaux d’Antonio Damasio que les émotions jouent un rôle essentiel dans la prise de décision. On a découvert récemment qu’elles pouvaient aussi nous aider à mieux prévoir l’avenir dans des domaines aussi différents que la politique, la culture, l’économie et même la météo ! Des résultats étonnants, qui posent de nouvelles questions : pourquoi les personnes qui font confiance à leurs émotions parviennent-elles à mieux anticiper les événements ? Quel processus cognitif Qui se rapporte à la connaissance, relatif à la mémoire, au langage, au raisonnement, à l'apprentissage, à l'intelligence, à la résolution de problèmes, à la prise de décision, à la perception et à l'attention. Qui se rapporte à la connaissance, relatif à la mémoire, au langage, au raisonnement, à l'apprentissage, à l'intelligence, à la résolution de problèmes, à la prise de décision, à la perception et à l'attention. entre en jeu ? Sommes-nous tous égaux face à cette disposition ? Voici les réponses qu’une équipe américaine a tenté d’apporter à ces questions.
Nouvelle Star ou météo : les «intuitifs» font de meilleures prévisions que les «rationnels»
L’étude [1] date de 2012. Elle est cosignée par trois professeurs de marketing, Michel Pham, Leonard Lee (Columbia Business School) et Andrew Stephen (Insead).
S’appuyant sur les travaux montrant le rôle des émotions dans la prise de décision, nos trois chercheurs ont voulu savoir ce que la prise en compte des émotions pouvait donner dans le domaine des prévisions. Pour cela, ils se sont livrés à une série d’expériences dans des domaines aussi différents que les primaires au sein du camp démocrate, le jeu télévisé American Idol (équivalent de la Nouvelle Star), le classement des films du box-office, le cours du Dow Jones ou la météo du week-end…. Pour chaque série, ils ont constitué deux groupes de participants : d’un côté, les « intuitifs », chez qui la confiance accordée aux émotions avait été favorisée ; de l’autre, les « rationnels », chez qui elle avait été au contraire réduite. [2]
Résultat sans appel : dans tous les cas, les « intuitifs » ont fait de meilleures prédictions que les « rationnels ». L’écart avoisine 20%, toutes expériences confondues : ce n’est pas rien ! D’où le titre de l’étude : « Feeling the Future : the Emotional Oracle Effect » (« Sentir le futur : l’effet oracle des émotions »).
Et si l’intuition était un raccourci vers la bonne solution ?
Comment expliquer un tel phénomène ? Les chercheurs ont d’abord fait l’hypothèse que les « intuitifs » étaient avant tout capables de prendre en compte les comportements collectifs pouvant influencer le cours des événements. Mais alors, comment expliquer qu’ils soient aussi capables de mieux prévoir le temps qu’il fera ? Ils ont donc avancé une autre hypothèse : et si les personnes qui font confiance à leurs émotions avaient un accès direct – une « fenêtre privilégiée », disent les auteurs – aux informations que nous avons enregistrées tout au long de notre vie, de façon consciente ou non ?
A chaque instant, en effet, notre cerveau reçoit une multitude d’informations. Son rôle est de les analyser et de les trier, en séparant celles qui sont utiles des autres. Les premières sont exploitées immédiatement ou mémorisées, les autres sont « oubliées », ou plutôt stockées sous une forme non explicite. Que suggèrent les résultats de l’expérience menée par Michel Pham et ses collaborateurs ? Nos émotions refléteraient ce que notre expérience, consciente et inconsciente, nous dit de telle circonstance, tel événement ou tel choix. En somme, nos émotions seraient un raccourci indiquant succinctement ce qui semble le plus plausible par rapport à ce que nous avons appris du monde qui nous entoure.
L’ «effet oracle» ne marche pas à tous les coups
On le voit, les émotions peuvent se révéler particulièrement utiles face à des décisions complexes pour lesquelles il est difficile d’intégrer de façon consciente tous les facteurs à prendre en compte. Dans ce type de situation, une prévision compatible avec les connaissances implicites contenues dans notre cerveau susciterait une émotion positive (« je le sens bien »), et inversement.
Il faut toutefois relativiser la portée de cet « effet oracle ». Si les prévisions sont améliorées chez les sujets qui font confiance à leurs émotions, elles sont loin de se vérifier à coup sûr. Hormis pour le test des primaires aux élections présidentielles, le taux de prévisions correctes ne dépasse pas 50% (taux généralement associé à la chance !). Il n’est donc pas question de se passer de nos compétences rationnelles pour prendre une décision ou anticiper les événements.
- 1. M. Tuan Pham, L. Lee, A.T. Stephen (2012). Feeling the Future: The Emotional Oracle Effect, Journal of Consumer Research
- 2. Avant de faire leur prédiction, les participants faisaient un petit exercice présenté comme une courte étude indépendante : se souvenir de décisions pour lesquelles ils considéraient avoir bien fait de suivre leurs émotions. Les participants du groupe des « intuitifs » devaient n’en décrire que deux, tandis que ceux du groupe des « rationnels » devaient en décrire dix. Il est assez facile de se souvenir de deux exemples, ce qui donne confiance à ses émotions. En revanche, il est difficile de s’en remémorer dix, ce qui réduit la confiance accordée aux émotions.