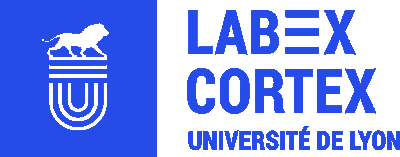Ce que nous avons retenu de l’actualité des neurosciences de cette quinzaine dans les médias grand public.
- Cognition. Thomas Edison ou Salvador Dali étaient tellement convaincus que l’endormissement est propice à la créativité qu’ils avaient développé une méthode pour capturer ces fulgurances. Des chercheurs ont reproduit leur procédé et vérifié qu’ils avaient raison. (The Conversation)
- Cellules souches. Espoirs et inquiétudes suscités par les organoïdes cérébraux. (Sciences et Avenir, abonnés)
- Imagerie. Les différences cérébrales entre les sexes ne se réduisent pas aux différences de taille du corps. (The Conversation)
- Sommeil. La recherche au chevet de notre mauvais sommeil. (Le Monde, abonnés)
- IA. Zoom sur Athénan, une IA qui a raflé la mise lors d’une compétition mondiale multijeux pour intelligences artificielles. (CRNS, Le Journal)
- TDAH. L’hyperactivité des adultes TDAH enfin reconnue, la Ritaline pourra leur être prescrite. (Sciences et Avenir, abonnés)
- Musicothérapie. De Parkinson aux lésions cérébrales, l’intérêt thérapeutique de la musique se confirme. (The Conversation)
- Cognition. Les macaques aussi apprennent de leurs erreurs. (Cortex mag)
- Psychiatrie. Hystérie : la fin d’un mystère ? On en sait plus sur les troubles neurologiques fonctionnels. (Cerveau et Psycho, abonnés)
- Neurosciences. Une communication émotionnelle joyeuse synchronise l’activité cérébrale. (Sciences et Avenir)
- Handicap. Une technique d’électrostimulation permet à des personnes avec un handicap moteur des membres inférieurs de faire du rameur. (BFM Lyon, vidéo)
- Attention. Notre attention ne cesserait de s’allumer et de s’éteindre jusqu’à 10 fois par seconde, sans même que nous nous en apercevions. (Cerveau et Psycho, abonnés)
- Zoologie. Les corbeaux confrontés à la peur de la nouveauté. (Le Monde, abonnés)
- Zoologie. Des chercheurs américains ont essayé de comprendre comment, avec un aussi petit cerveau, les araignées réussissent à tisser des toiles aussi fines que complexes. (Le Monde, Vidéo)
- Alzheimer. Il n’y aurait pas une maladie d’Alzheimer, mais trois. (Université de Genève)