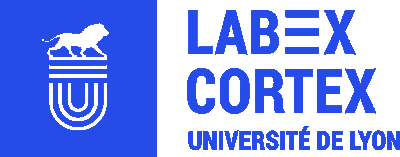Enseignant-chercheur en neuropsychologie, George A. Michael mène des travaux sur la cognition des différents acteurs du monde judiciaire : délinquants et criminels, mais aussi témoins, victimes ou experts de la justice. (Croquis d’audience : Sylvie Guillot.)
George A. Michael s’intéresse depuis quelques années à l’apport des sciences cognitives à la criminalistique, ou forensique, approche pluridisciplinaire consistant à établir la preuve de la culpabilité d’une personne mise en cause dans un crime ou un délit à partir de diverses méthodes d’analyse scientifique : chimie, physique, biologie, neurosciences, informatique, imagerie, statistiques… Il a même créé une unité d’enseignement de « criminalistique cognitive » à l’université Lumière-Lyon 2. Épaulé par deux doctorants, Romain Bet (« Diminuer le risque de récidive : peut-on se baser sur la personnalité des personnes placées sous main de justice pour développer un dispositif cognitif adapté ? », lire son interview) et Geoffrey Duran (« Compréhension, attention et émotions : une nouvelle approche de la détection du mensonge »), il propose un demi-cycle spécifique aux étudiants de troisième année de psychologie, où il aborde notamment la cognition des auteurs de crime, mais aussi celle des témoins ou victimes, et celle des experts de la justice.
Essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d’un criminel, ce n’est pas franchement nouveau, non ?
Vous avez raison. La personnalité des criminels a toujours fasciné les foules et intéressé les esprits scientifiques. Cela mérite une brève mise en perspective historique. Partons du XIXe siècle, avec le développement de la criminologie. On a d’abord cherché à analyser le mode opératoire des criminels, leur signature en quelque sorte. Il s’agit d’une approche a posteriori du comportement. Plus tard, dans les années 1960, arrivent les sciences cognitives. Elles s’intéressent aux fonctions de base de la cognition humaine : mémoire, attention, perception, gestualité, etc., puis aux fonctions exécutives. On prend alors en compte les interactions sociales : c’est la naissance des sciences cognitives sociales. C’est dans cette sphère qu’on trouve des comportements comme le mensonge, la manipulation ou l’agression.
Et un jour, les sciences cognitives rencontrent la criminalistique…
C’est cela. Dans les années 1970, des chercheurs se sont intéressés à la fiabilité des témoins oculaires. Ils ont voulu savoir ce qui pouvait biaiser les souvenirs : perméabilité à d’autres informations, mais aussi à la façon dont les questions étaient posées. Depuis la fin des années 1990, les chercheurs se penchent sur la cognition des auteurs de délits ou de crimes. Ils essaient, par exemple, de comprendre, à partir du discours, le mode de fonctionnement cognitif d’agresseurs sexuels, de pédophiles ou de pyromanes. Et, depuis les années 2000, ils s’intéressent aussi à la cognition des experts ainsi qu’aux processus cognitifs qui aboutissent à des erreurs judiciaires. La démarche est complexe. Difficile, en effet, pour des raisons évidentes d’éthique, de s’appuyer sur la recherche expérimentale…
Comment procédez-vous alors ?
Romain Bet, doctorant de mon équipe, travaille sur la cognition de personnes ayant commis des agressions sexuelles. Grâce à des tests de personnalité, d’épreuves cognitives et l’analyse de discours, il essaie de comprendre comment elles perçoivent et comprennent le monde et comment elles passent à l’acte. Son objectif à terme est de mettre au point des méthodes permettant de réduire la récidive (lire son interview).
Ces travaux sont-ils prometteurs ?
Il est trop tôt pour le dire. Ce courant de recherche est encore novateur en France. Dans ce domaine, les pays anglo-saxons sont plus avancés. Il ne faut pas créer d’attentes trop fortes. Et ce n’est pas simple. En matière de sécurité, la société attend des réponses directes, or les sciences cognitives ne les apporteront pas. Rappelons-nous l’engouement pour la psychophysiologie il y a quelques décennies et le fiasco des soi-disant « détecteurs de mensonges ».