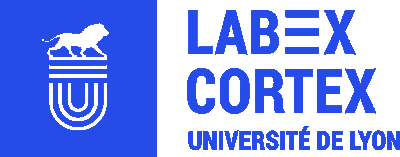«Nous n’utilisons que 10% des capacités de notre cerveau», «A chacun son style d’apprentissage», «Tout se joue avant 3 ans»… Nous croyons savoir beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre cerveau. Et si ces idées reçues ne tenaient pas debout ?
Notre époque se passionne pour le fonctionnement de notre cerveau. Un organe longtemps qualifié de « continent noir » jusqu’à l’avènement de l’imagerie cérébrale. Cette technologie révolutionnaire a permis de montrer non seulement l’intérieur du cerveau mais aussi de mettre en évidence l’activité qui s’y déroule en permanence. La fascination exercée par ces images est sortie des laboratoires et s’est bientôt répandue dans toute la société. On a cru qu’on allait enfin percer les mystères du cerveau, expliquer par le menu les mécanismes de la mémoire, de la prise de décision, de l’apprentissage, etc. et doper ainsi nos performances cognitives. Une véritable « neuromania » s’est emparée de nous, irriguant tous les secteurs de la société, de l’école à l’entreprise en passant par l’économie et la politique. C’est particulièrement vrai dans le monde de l’éducation, où les neurosciences ont pris une place prépondérante, notamment en matière de pédagogie. Hélas, cette vague charrie avec elle des fausses croyances qui se sont répandues sous forme de raccourcis séduisants mais approximatifs : «Nous n’utilisons que 10% des capacités de notre cerveau», «A chacun son style d’apprentissage», «Tout se joue avant 3 ans»… C’est ce qu’on appelle des « neuromythes ».
Cortex Mag souhaite apporter sa pierre au travail de déconstruction de ces idées fausses lancé depuis quelques années par des chercheurs en neurosciences et des pédagogues de tous horizons. Nous allons ainsi publier chaque mois un article sur l’un de ces neuromythes. Il sera réalisé par des étudiants volontaires du Master 2 Neurosciences fondamentales et cliniques (NFC) de l’université Claude-Bernard-Lyon-1, sous la supervision de Clara Saleri, doctorante au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL), et d’Yves Rossetti, professeur de physiologie à la faculté de médecine Lyon-Est et chercheur au CRNL.
Neuromythe #1 : les styles d’apprentissage
Nous aurions chacun un style d’apprentissage privilégié qui nous permettrait de mieux comprendre et mémoriser les connaissances : visuel pour les uns, auditif ou kinesthésique pour les autres. En réalité, on n’a jamais pu faire la preuve de la supériorité d’un enseignement qui adapterait sa pédagogie aux profils des individus. > Lire l’article.
Neuromythe #2 : la théorie des intelligences multiples
Linguistique, spatiale, logico-mathématique, musicale, naturaliste… Nous serions dotés d’intelligences multiples, indépendantes les unes des autres et inégalement distribuées. Ce qui expliquerait que certains soient doués pour les mathématiques, d’autres pour la musique et d’autres encore pour la danse. Après avoir connue un franc succès, cette théorie a été abandonnée. Y compris par son promoteur. > Lire l’article.
Neuromythe #3 : le volume du cerveau influence l’intelligence
Si l’intelligence dépendait de la taille du cerveau, les éléphants et les baleines seraient les rois du monde. En réalité, ni le volume du cerveau, ni son poids relatif, ni le nombre de neurones du cortex ne permettent d’établir une corrélation satisfaisante avec l’intelligence. Et personne n’a trouvé une définition de l’intelligence qui s’appliquerait à l’ensemble du monde animal… > Lire l’article.
Neuromythe #4 : l’effet Mozart
Écouter de la musique classique rendrait les enfants plus intelligents. Cette idée très répandue ne repose pourtant que sur une fragile expérience conduite dans les années 1990. Certes, la musique procure de nombreux bienfaits, mais pas celui-là ! > Lire l’article.
Neuromythe #5 : cerveau droit-cerveau gauche
Ceux qui utilisent plutôt leur cerveau gauche seraient plus logiques et analytiques, tandis que ceux qui utilisent leur cerveau droit seraient plus créatifs et intuitifs. Cette idée, encore très répandue, court depuis la fin du XIXe siècle, alimentée par de nombreux scientifiques et écrivains. Son origine vient d’une confusion entre asymétrie cérébrale et dominance hémisphérique. > Lire l’article.
Neuromythe #6 : apprendre en dormant
C’est le fantasme de tous les étudiants : que d’efforts évités, que d’heures gagnées s’il était possible d’apprendre en dormant. Hélas, même si des études récentes ont montré que, dans certaines phases de sommeil, le cerveau était capable de retenir des sons simples ou de faire des associations sémantiques, on n’est pas près d’apprendre une langue étrangère en dormant. > Lire l’article.
Neuromythe #7 : le cerveau des hommes est différent de celui des femmes
Si les hommes et les femmes ne raisonnent pas de la même façon, c’est que leur cerveau est différent. Une thèse vieille comme le monde, qui a longtemps nourri la misogynie avant d’être laminée par les neurosciences et les sciences humaines et sociales. Mais aujourd’hui, les choses ne sont plus aussi claires. > Lire l’article.
Neuromythe #8 : le cerveau reptilien et la théorie du cerveau triunique
C’est une expression qu’on entend couramment dans les conversations pour désigner la source de nos comportements primitifs – et pas toujours les plus dignes. Le concept de cerveau reptilien se rattache en fait à la théorie du cerveau triunique développé dans les années 60 par un certain Paul MacLean. Bien que rapidement invalidée, elle a connu une belle carrière. > Lire l’article.
Neuromythe #9 : tout se joue avant 3 ans
Derrière ce message anxiogène pour les parents et les éducateurs se cache une vision déterministe du développement de l’enfant. Si les premières années sont effectivement cruciales, les apprentissages et l’acquisition de nouvelles compétences se poursuivent tout au long de la vie. > Lire l’article.
Neuromythe #10 : oui, vous pouvez muscler votre cerveau !
Il serait possible d’améliorer ses capacités cognitives en s’entraînant régulièrement comme on le fait pour entretenir ses capacités physiques. Cette idée séduisante a suscité un marché lucratif de programmes de « brain training ». Pourtant, les fondements scientifiques sur lesquels ils reposent sont bien fragiles… > Lire l’article.
Neuromythe #11 : le cerveau multitâche
Faire plusieurs choses simultanément est devenu courant et parfois obligatoire pour répondre aux injonctions de notre société. Mais quels sont les effets de ce phénomène sur le cerveau ? Est-il vraiment capable de traiter deux tâches en même temps ? Rien n’est moins sûr… > Lire l’article.
Neuromythe #12 : les HPI sont-il vraiment plus intelligents que la moyenne ?
Certes, ils ont un QI supérieur à 130, sont plus efficients que le commun des mortels dans leur domaine de prédilection et possèdent un cerveau spécialement bien connecté. Mais ils ont surtout une façon différente de traiter l’information et de raisonner. > Lire l’article (en cours de révision)